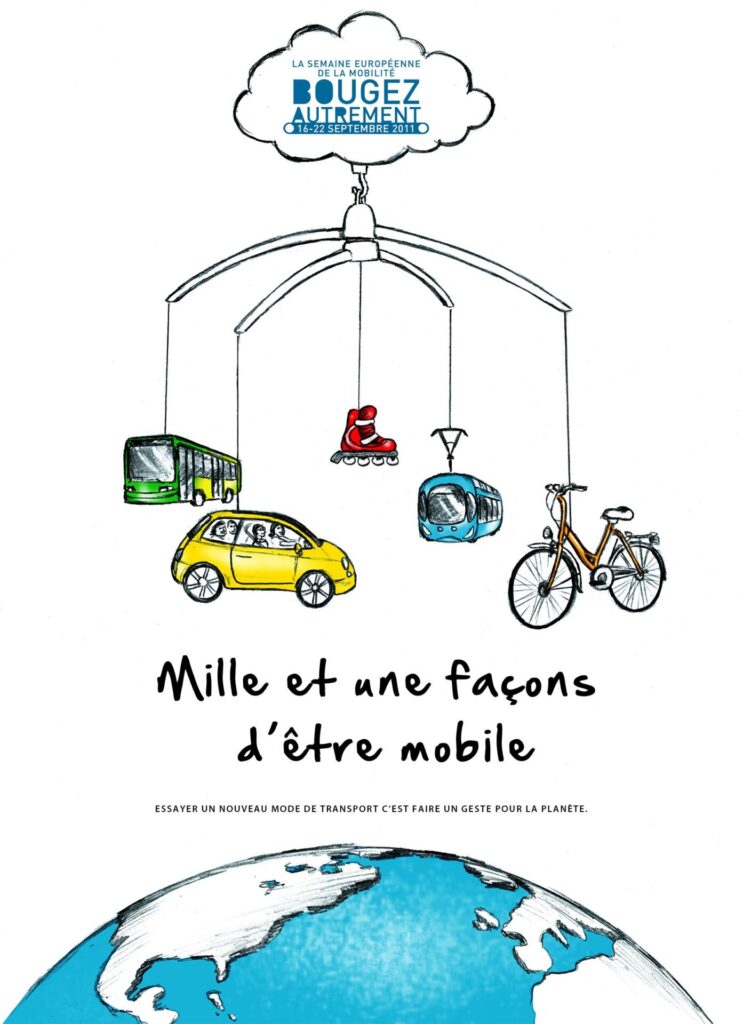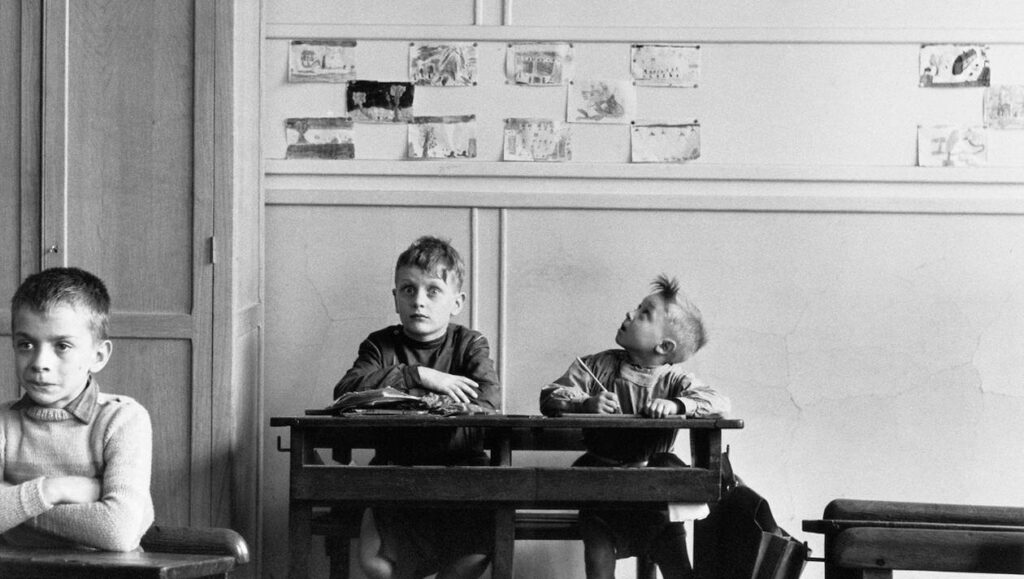
Robert Doisneau : 1957- La pendule
Le rapport que la Cour des comptes vient de consacrer à l’enseignement primaire présente deux mérites : replacer ce sujet au centre du débat, dresser un constat objectif et alarmant d’une école « en décalage avec les besoins de l’élève » ; il confirme la gravité d’une situation que je ne découvre malheureusement pas, représentant l’Association des Petites Villes de France dans les réunions entre ministre et associations d’élus, format de réunion initiées par Pape N’Daye.
Depuis son départ (juillet 2023) et les 4 Ministres de l’Éducation qui se sont succédés, nous ne nous étions plus réunis. Point positif, Elisabeth Borne vient de relancer un Comité des élus avec les différentes associations auquel j’ai participé.
Dans son analyse, la Cour des Comptes indique quatre tendances de fond qui caractérisent notre école : la dégradation continue du niveau des élèves, l’augmentation constante de la dépense publique, l’accroissement des inégalités sociales et territoriales selon l’origine des familles ou le lieu de résidence, la diminution historique du nombre d’élèves.
Il faudrait y rajouter 20 ans après la loi de 2005 sur l’égalité des droits, l’augmentation du nombre d’élèves en situation de handicap qui représentent désormais plus de 4% des élèves scolarisés (500 000).
Vu les moyens financiers, logistiques et humains mobilisés, les résultats ne sont pas à la hauteur, ce que ne manque pas de souligner, avec justesse, les sages de la rue Cambon qui considèrent que « l’école du premier degré doit, évoluer impérativement dans son organisation et son fonctionnement ». Leurs propositions sont pour l’essentiel identifiées depuis des années : formation initiale et continue des enseignants, re qualification du métier, statut des directeurs …
Si l’on excepte un focus sur les rythmes scolaires ou l’évocation du « bien être de l’élève », la Cour des Compte reste dans sa ligne d’eau : demande de création d’indicateurs de pilotage permettant d’évaluer le montant réel de la dépense publique (à priori sous-estimée) et le niveau scolaire des élèves à la maille territoriale la plus fine …
Une de leurs recommandations se doit cependant d’être nuancée et mise en perspective avec la réalité des territoires : « systématiser les regroupements pédagogiques ou d’écoles ». N’oublions pas que l’école constitue un élément essentiel de l’aménagement du territoire, et qu’une journée d’élève se doit d’intégrer le temps passé dans les transports pour se rendre à l’école ou rentrer chez soi.
Traiter de l’éducation impose de privilégier une vision globale, systémique intégrant les différents acteurs, dont les collectivités. L’école est à la convergence des transitions auxquelles est confrontée notre société, et constitue également, trop souvent, un révélateur de ses fractures et de ses failles. Montesquieu l’écrivait, bien avant l’émergence d’ Internet ou de l’IA « Nous recevons aujourd’hui trois éducations différentes ou contraires : celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde. Ce qu’on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des premières … ».
Certains angles morts font selon moi défaut au diagnostic des magistrats financiers :
• L’action sur le « travail personnel » de l’élève et le « hors école », puissants discriminants sociaux s’il en est, ce qui impose une collaboration plus étroite avec les communes ;
• L’intégration des usages numérique et leur maitrise au cœur des enseignements, il est réducteur de limiter cette problématique aux seuls écrans ;
• Faire émerger une école bienveillante, adaptée aux transitions et au service d’une pédagogie plus interactive et collaborative ;
• L’école inclusive. Le nombre croissant d’enfants en situation de handicap impose de mettre en place, avec les différents acteurs impliqués, une organisation plus humaine, fluide et efficiente ;
Le rapport insiste sur la nécessité de renforcer la concertation avec les collectivités, soulignons cependant que cette dernière ne se limite pas au seul irritant de la carte scolaire, sujet de friction récurrent entre services de l’état et collectivités.
Concernant la problématique du temps de l’élève, il convient cependant de ne pas oublier le désordre causé et l’échec des précédentes réformes liées aux rythmes scolaires. Le sujet nécessite une approche apaisée, sereine et concertée avec tous les acteurs concernés, y compris économiques, et n’est pas uniquement du ressort de la seule rue de Grenelle.
Il serait sans doute utile et rapide, en intégrant les contraintes budgétaires des uns et des autres, de réfléchir à une articulation plus fluide entre temps scolaires et périscolaires d’une journée d’élève en menant en parallèle une réflexion de fond sur les notions de « travail personnel » et du « hors école » afin d’agir plus efficacement contre la discrimination scolaire et le déterministe social mùais également d’intégrer tous les enseignements des émeutes de juin 2023.
D’autre pistes de réflexion commune, dans lesquelles nos communes ont un rôle déterminant mériteraient sans doute une concertation plus étroite entre Éducation Nationale et collectivités : bâti scolaire, espaces extérieurs, mobilier, usages liés au déploiement d’un numérique éducatif qui ne se limite pas aux seuls écrans …
Au regard de la gravité du constat, de l’urgence de la situation que souligne ce rapport utile de la Cour des Comptes, il est bon de rappeler que les collectivités sont disponibles, prêtes à agir aux cotés et en concertation avec le ministère de l’Éducation nationale et les acteurs éducatifs (dont la CAF).
L’éducation est un devoir républicain et citoyen partagé et commun, mais également et surtout un investissement stratégique prioritaire du pays pour son futur.
Notes précédentes