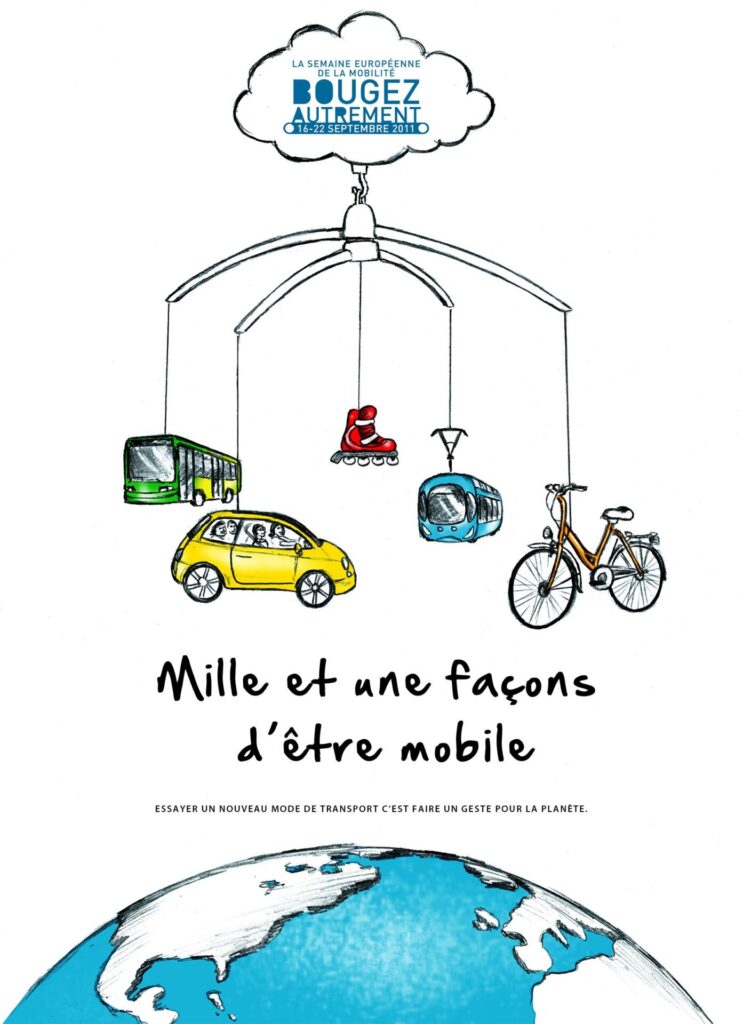
L’opportunité de deux expérimentations menées localement m’a donné l’occasion d’être confronté concrètement à la problématique du transport à la demande. J’en ai tiré quelques propositions rassemblées en une note, tant le TAD constitue un gisement de mobilités particulièrement adapté aux espaces ruraux et péri urbains malheureusement toujours inexploité aujourd’hui.
Pourtant ne pas avoir la capacité de se déplacer librement dans une société de plus en plus mobile (« mobilis in mobili ») conduit les habitants de certains territoires à l’exclusion, le déclassement et à un fort sentiment de relégation vis-à-vis des métropoles d’autant que ce contexte les rend totalement dépendant de la voiture particulière.
Le Pays de Meaux est une des trois intercommunalités du pays concernées par l’expérimentation «Terr’Moov» porté par l’association Wimoov, dont l’objectif est d’activer les leviers permettant de lever les freins à la mobilité et à l’emploi dans les zones peu denses. Dans le cadre de cette expérimentation, les retours d’expérience collectés auprès des habitants sont sans équivoque, les TAD mis en place par l’autorité organisatrice ne trouvent pas leur public, faute d’attractivité (amplitude notamment)
Cette situation reflète le retard de l’Ile-de-France en ce domaine. Il peut se comprendre au regard de la priorité donnée au développement et à la rénovation du réseau ferré (voir note précédente), les politiques de mobilités déployées concernant quasi exclusivement le développement du réseau de petite couronne. Jusqu’à la loi LOM la desserte des zones rurales ne constituait pas une priorité, l’effort étant principalement orienté vers les systèmes « mass transit pendulaire ».
En contrepoint, l’expérimentation nationale menée par Tech4Mobility (« J’y vais »), l’accélérateur d’innovations de la SNCF dédié aux nouvelles mobilités, sur les territoires du Pays de l’Ourcq et du Pays de Meaux ouvre bien des perspectives.
Elle visait à tester l’impact d’une offre TAD, prototypée et « désign é » spécifiquement pour les territoires peu denses et a rencontré son public après seulement 6 mois de fonctionnement. Un résultat plus qu’appréciable tant il est difficile de lancer une offre éphémère, au concept disruptif, sur deux intercommunalités voisines mais différentes, en période estivale.
Irriguer avec équité tous les territoires, desservir finement les zones peu denses jusqu’au dernier kilomètre exige qu’élus, acteurs institutionnels et autorités organisatrices sortent du « tout infrastructure » et des solutions « classiques » pour privilégier une vision systémique et inclusive des mobilités. C’est ainsi que nous pourrons enfin éviter toute assignation à résidence. Or, de manière générale, l’offre TAD développée en Ile-de-France se limite pour l’instant à une offre de niche ou d’affichage et n’est pas intégrée nativement dans la stratégie globale de mobilités d’un territoire.
Il faut pourtant souligner tout l’intérêt de ce mode de déplacement, tant il est agile, souple, interactif, et voir son efficacité décuplée par le dividende numérique. Aujourd’hui inexploité, il a la capacité de s’adapter de multiples contextes : de la desserte des zones peu denses à des usages plus thématiques ou atypiques concernant également les espaces urbains et peut s’intégrer sans problème dans l’offre multimodale d’un bassin de mobilités.
Voici, quelques propositions qui pourraient permettre de le développer pour le plus grand bien des espaces péri urbains et ruraux de la grande couronne francilienne notamment …

La Loi d’Orientation des Mobilités (2019) fait de la lutte contre les « zones blanches de mobilité » un enjeu de l’action publique et souligne l’importance de piloter des stratégies permettant de desservir tous les territoires composant un « bassin de mobilité ».
Le succès de l’expérimentation « J’y vais », repose principalement sur trois facteurs : l
La souplesse et l’efficacité de la solution numérique déployée ;
L’accessibilité universelle du service dont la possibilité de réserver son trajet par téléphone et la facilité de paiement ;
et une des principales clés de cette réussite, véritable partie immergée de l’iceberg, le travail amont qui a préludé autour de l’élaboration du design de l’offre (définition du produit, des publics cibles, packaging et prototypage) suite à un diagnostic territorial très fin intégrant une analyse sociologique poussée.
En contrepoint cinq dimensions font, selon moi, défaut au modèle de TAD, tel que proposé aujourd’hui par IDF mobilités.
- L’absence de diagnostic territorial amont, pourtant incontournable pour obtenir la meilleure adéquation entre offre et demande en mobilités, tenir compte des besoins des habitants. Elle doit constituer le préalable à tout déploiement sur chaque bassin de vie afin de tenir compte de ses spécificités ;
- L’utilité du service proposé. Une idée simple, voir simpliste : pour qu’un TAD soit utilisé, encore faut-il qu’il soit utile à ses usagers tant sur l’aller que le retour. La question de la communication se pose bien après. En matière de mobilités quotidienne il ne peut y avoir d’aller simple. L’amplitude et la fréquence sont deux piliers essentiels ;
- L’ouverture d’une offre de service aujourd’hui trop cloisonnée, ne mêlant pas différents publics d’usagers se déplaçant selon des temporalités différentes ;
- La qualité de la digitalisation et de la plateforme numérique. C’est une des clés permettant de développer l’offre, et notamment de renforcer son modèle économique (attractivité, taux de groupage) ;
- Déployer une offre packagée et dédiée au TàD. Il faut souligner l’importance de paramètres tels l’appellation de l’offre, la livrée des véhicules, la lisibilité de la promesse, le fléchage dans les plateformes multimodales, qui constituent autant d’atouts ;
Le transport à la demande apparaît aujourd’hui en Ile de France comme une véritable opportunité, car :
- De plus en plus de franciliens, auparavant urbains, vivent dans les espaces péris urbains et ruraux de la grande couronne, qui connaissent une poussée démographique continue (loi SRU, gentrification des centres villes et déplacement des habitants …) surtout en Seine et Marne ;
- Vieillissement de la population. Le TAD participe au maintien à domicile des personnes âgées et à la survie des espaces ruraux contribuant à prolonger l’autonomie résidentielle ;
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’usage de la voiture individuelle là où elle demeure pour l’instant toujours incontournable. Tant le TaD constitue une alternative qui permet de limiter les contraintes croissantes liées à l’utilisation d’une voiture pour se rendre en zone urbaine (stationnement, ZFE …) ;
Le TAD ouvre un large champ de perspectives tant il a la capacité de s’adapter à beaucoup de territoires et types de demande, selon la densité de la zone desservie, la spécificité de la demande (offre de nuit, de weekend, destinations thématiques : desserte hospitalière par exemple …) et l’utilité « sociale » du service afin d’organiser des déplacements thématiques non couverts par les réseaux structurants.
Comme tout type de transport public, le TàD n’est pas «rentable» en tant que tel, son modèle économique intègre inévitablement des subventions, un point commun qu’il partage avec tous les modes de mobilités.
Il faut tenir compte de certains biais concernant son « évaluation ». Vu le nombre limité de réseaux déployés en Ile-de-France dans le cadre d’une offre globale et multimodale, les opérateurs manquent de recul et de retours pour maitriser toutes les pistes d’optimisation logistiques et financières, contrairement aux réseaux de bus pour lesquels ils ont développé toute une batterie d’indicateurs leur permettant de « traquer » les pistes éventuelles d’économie. En matière de TàD, un des ratios clés est le taux de groupage. Il fait référence à la fréquence à laquelle des passagers partagent un itinéraire commun dans un même véhicule. Plus il est élevé, plus le service est efficace et efficient au niveau de son modèle économique.
D’autant que d’autres mutualisations pourraient être sans doute envisageables dans le futur afin d’accompagner l’autonomie résidentielle des seniors vieillissement croissant de la population : PMR et TàD publics (véhicules mixtes et personnels
Intégré au plan de mobilités multimodal d’un territoire, le transport à la demande devient une des composantes d’une l’offre globale qui se doit de répondre aux besoins de tous ses usagers y compris ceux vivant dans les espaces les moins denses et qui n’oublie pas le dernier kilomètre.
Il ouvre de nouveaux droits à la mobilité et propose une réelle alternative à la voiture individuelle ; contribuant au report modal il peut être considéré comme une des briques d’un continuum de solutions de services de mobilité des transports en commun classiques (ferrés ou/et bus), l’autopartage, le covoiturage connectées aux différents hubs déployés sur le territoire.
C’est bien l’ensemble d’une chaine de déplacements, comme sa cohérence, sa complémentarité et sa fluidité qui fait sens, encore faut-il qu’elle n’oublie aucun territoire pour être réellement inclusive, c’est tout l’enjeu de développer dans nos territoires le Transport à la Demande.
